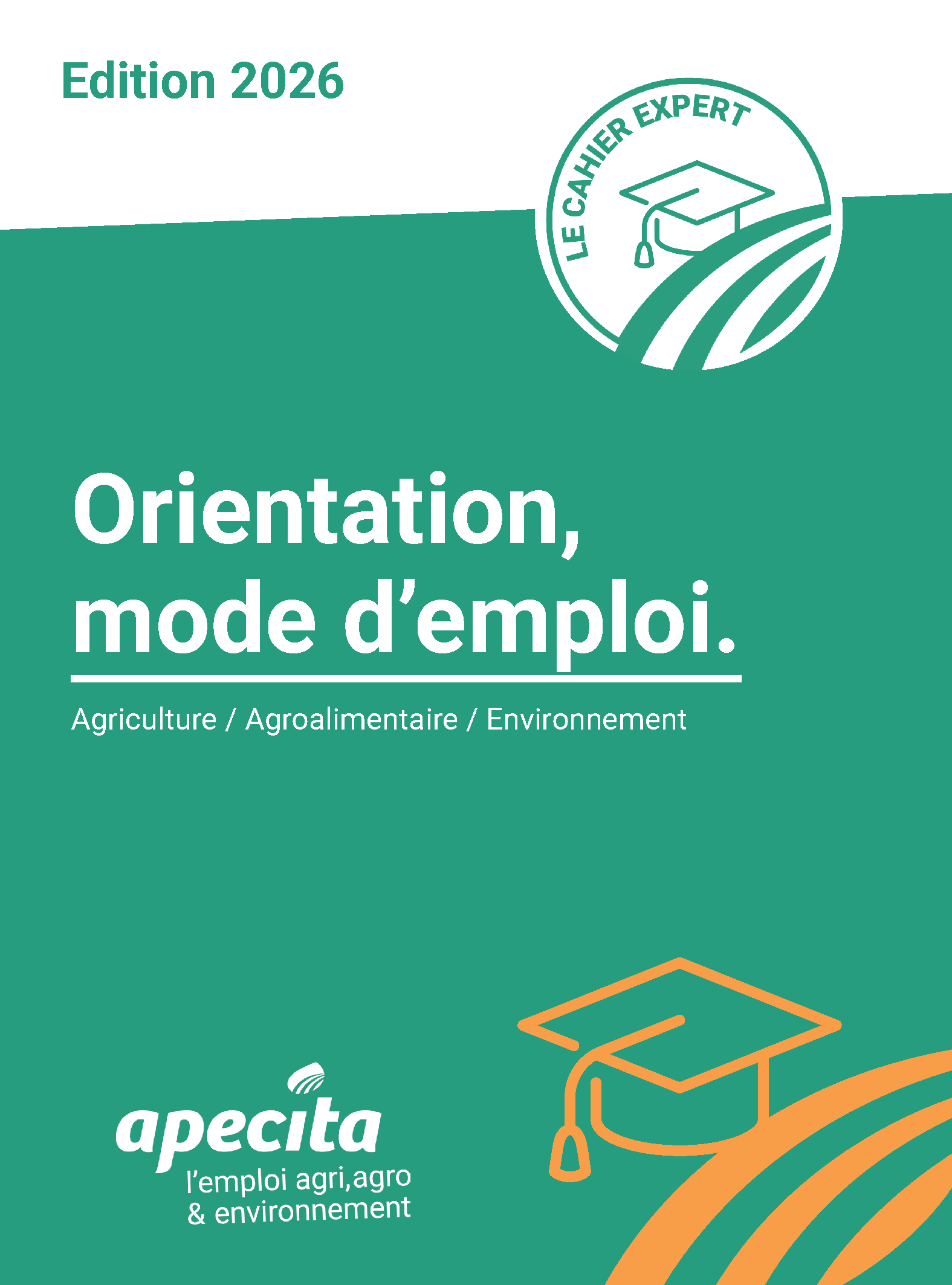Agriculture biologique: quatre futurs possibles à l’horizon 2040
Un secteur à la croisée des chemins
Entre marginalisation et généralisation, l’agriculture biologique française se trouve à un tournant stratégique. Une étude prospective récemment publié par le Ministère de l’Agriculture rappelle que son avenir dépendra autant des politiques publiques que de la capacité des acteurs à s’unir, innover et convaincre les consommateurs. À l’horizon 2040, la bio pourrait rester une niche… ou devenir la norme.
En vingt ans, l’agriculture biologique (AB) a connu une expansion spectaculaire en France avant de traverser une crise sévère à partir de 2022. Alors que les surfaces en conversion ralentissent et que les ventes stagnent, le ministère de l’Agriculture a commandé une étude prospective, confiée à Ceresco et au Crédoc, afin d’explorer les trajectoires possibles du bio d’ici 2040. Les résultats, publiés en août 2025 dans l’Analyse n° 221 du Centre d’études et de prospective, dessinent quatre scénarios contrastés : entre marginalisation et généralisation de l’AB.
Un secteur fragilisé mais encore structurant
En 2023, l’agriculture biologique représente 14 % des exploitations françaises, 19 % des emplois agricoles, 10,4 % de la SAU et 6 % des ventes alimentaires. Après une croissance continue jusqu’en 2020, le marché plafonne désormais autour de 12,1 milliards d’euros, affecté par la baisse du pouvoir d’achat, l’inflation alimentaire et la concurrence d’autres démarches environnementales. Les surfaces en conversion reculent depuis 2021, signalant une perte de dynamique.
Quatre scénarios prospectifs
L’étude prospective repose sur vingt variables et les contributions d’un groupe d’acteurs de la filière. Les scénarios ne visent pas à prédire l’avenir, mais à éclairer décideurs et professionnels sur les évolutions possibles.
1. Croissance contrariée puis résilience
L’AB se marginalise face aux priorités économiques et à la mondialisation. Les circuits courts résistent, mais le label européen disparaît, remplacé par des initiatives locales. La bio survit surtout auprès d’une clientèle aisée.
2. La « 3e voie » triomphante
Des standards environnementaux intermédiaires, portés par les multinationales, séduisent consommateurs et pouvoirs publics. Le bio recule sous les 3 % des dépenses alimentaires en 2040, cantonné à une niche militante ou exportatrice.
3. Un standard bio assoupli et généralisé
Un accord international en 2032 dope les conversions. Pour massifier, le cahier des charges européen est allégé, ce qui accroît la compétitivité mais suscite des débats internes. En 2040, le bio atteint 30 % du marché alimentaire.
4. Le bio prédominant
Dans un contexte de démondialisation et de politiques convergentes santé-environnement, l’AB devient la norme agricole de l’UE. Incitations financières, politiques foncières et obligations réglementaires permettent une généralisation du bio dans les filières et la consommation collective.
Quels leviers pour l’avenir ?
Au-delà des scénarios, les auteurs soulignent des leviers déterminants :
- Maintenir une offre accessible en distribution et en restauration collective ;
- Renforcer les infrastructures (collecte, transformation, capital humain) ;
- Améliorer la compétitivité par l’internalisation des externalités environnementales ;
- Valoriser la santé et la qualité comme moteurs de la consommation ;
- Accroître l’éducation et la visibilité scientifique pour ancrer durablement le choix du bio.
Nos dernières sorties :
Devenez un acteur de la filière agricole.
Plus de 1200 offres d'emplois partout en France.