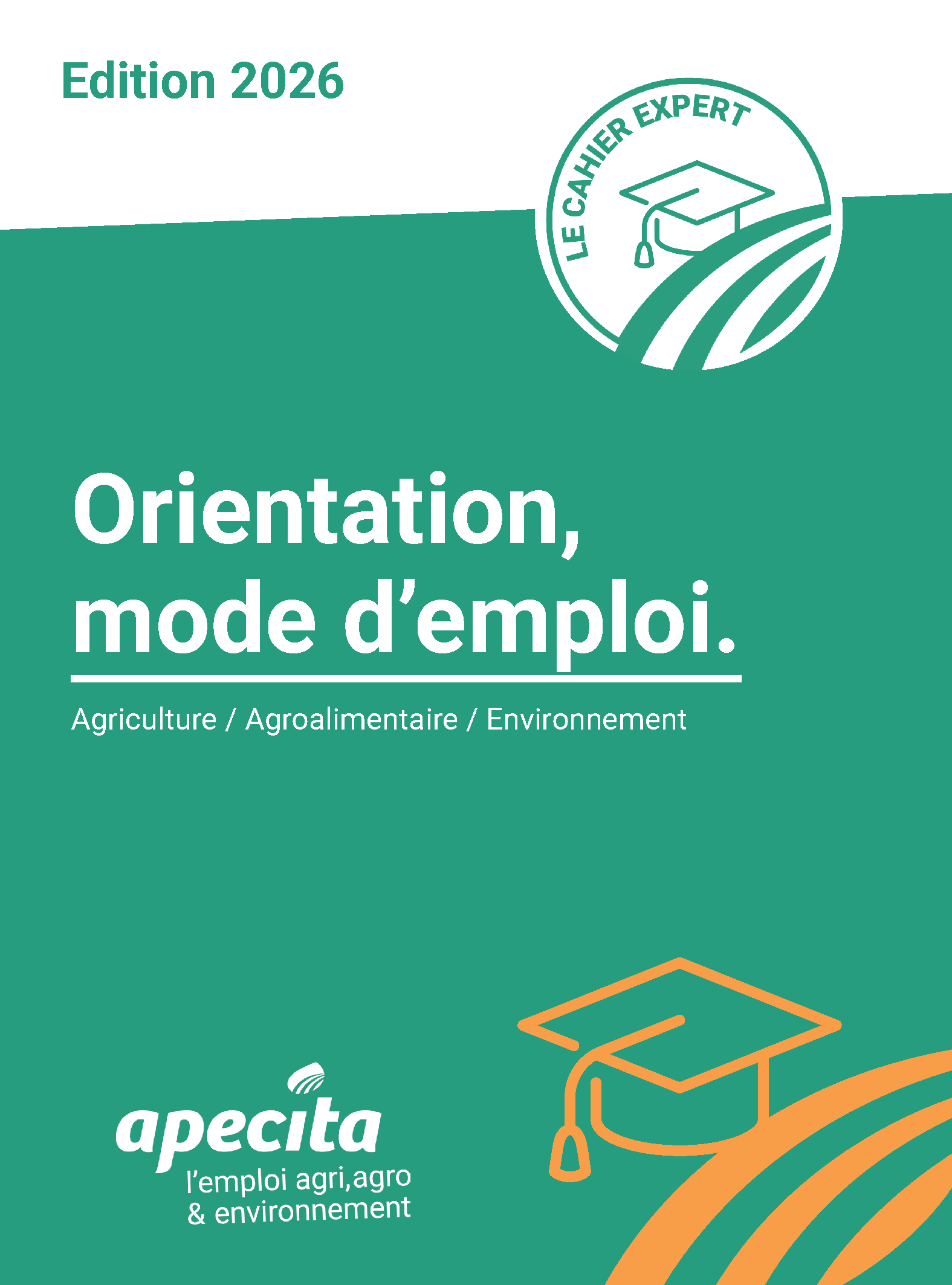Innovation agricole : un moteur sous-exploité pour la transition agroécologique
La Cour des comptes vient de livrer un état des lieux sur l’efficacité des dispositifs publics en faveur de l’innovation agricole. Si les investissements sont conséquents, les résultats peinent à suivre, freinés par des obstacles économiques, organisationnels et structurels.
Entre 2018 et 2023, l’État a investi près de 6,7 milliards d’euros pour stimuler l’innovation dans le secteur agricole. Un engagement financier fort qui s’inscrit dans une ambition stratégique : accompagner la transition agroécologique et répondre aux défis économiques, environnementaux et climatiques de l’agriculture française.
L’innovation, qu’elle soit numérique, robotique ou génomique, est perçue comme une clé pour bâtir une agriculture compétitive, résiliente et respectueuse de la biodiversité. Cette démarche s’inscrit dans ce que les pouvoirs publics qualifient de « troisième révolution agricole ».
Une adoption freinée sur le terrain
Malgré cet engagement financier, la Cour des Comptes pointe une réalité contrastée : 86 % des agriculteurs affirment intégrer des innovations dans leurs pratiques, mais aucune solution ne s’impose réellement dans toutes les exploitations.
Les alternatives aux produits phytosanitaires, bien qu’en tête des pratiques innovantes adoptées, peinent à dépasser la barre des 50 % des exploitations. Et pour cause : les freins sont nombreux, à commencer par le poids du risque financier, que l’agriculteur doit souvent assumer seul.
Le retour sur investissement, long et incertain, freine l’adoption de solutions pourtant indispensables à la transition écologique. Faute d’un cadre sécurisant et de références techniques suffisantes, les producteurs avancent souvent à tâtons.
Un accompagnement à parfaire
Autre point faible relevé par la Cour des Comptes : le déficit d’accompagnement structuré. Si les agriculteurs plébiscitent les conseils lorsqu’ils y accèdent, beaucoup n’y ont tout simplement pas recours. Seuls 44 % des exploitants interrogés déclarent solliciter les chambres d’agriculture, pourtant actrices historiques du conseil.
La formation continue reste en retrait par rapport à d’autres secteurs économiques, un frein d’autant plus visible que la profession accueille de plus en plus de nouveaux venus, non issus du monde agricole.
Les collectifs agricoles jouent un rôle d’entraide et de diffusion des savoirs, mais l’engagement dans des démarches structurées — notamment labellisées agroécologiques — reste marginal, avec moins de 10 % d’adhésion.
L’Agritech française en pleine effervescence, mais en quête de maturité
Sur le front des technologies, la France peut néanmoins compter sur une Agritech dynamique, portée par plus d’une centaine d’acteurs — start-up, PME, consortiums publics-privés. Ces entreprises, soutenues par 2,4 milliards d’euros d’investissements publics depuis 2021, développent des solutions qui répondent aux attentes de durabilité et d’efficacité.
Mais là encore, les obstacles sont nombreux : cloisonnement entre anciens et nouveaux acteurs, accès difficile aux marchés, procédures d’autorisation longues… autant de freins qui ralentissent la montée en puissance de ces innovations dans les exploitations.
Une politique publique à ajuster
Si les fondations sont solides, la Cour des Comptes souligne plusieurs lacunes : l’absence de feuille de route claire pour organiser le conseil, la formation continue et l’accès des entreprises innovantes à l’expérimentation.
L’agriculture française dispose des compétences et des moyens pour réussir sa transition, mais reste confrontée à une problématique de diffusion et d’appropriation des innovations. Une équation délicate qu’il faudra résoudre pour transformer réellement l’essai et donner corps à une agriculture à la fois performante et durable.
Source : Cour des Comptes
Nos dernières sorties :
Devenez un acteur de la filière agricole.
Plus de 1200 offres d'emplois partout en France.